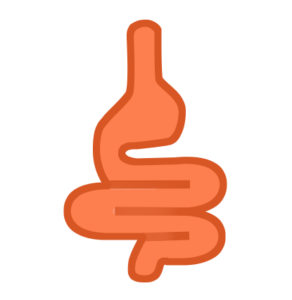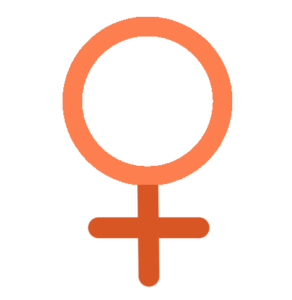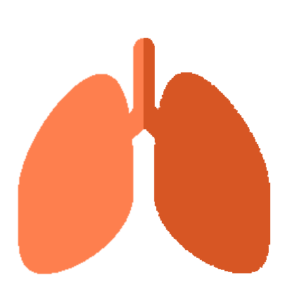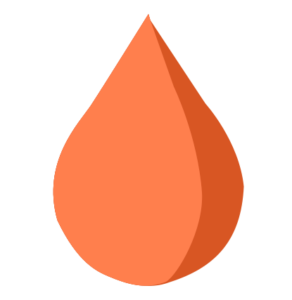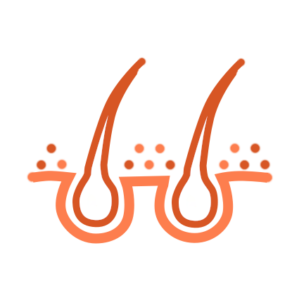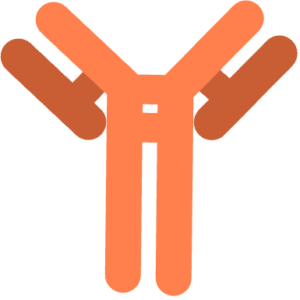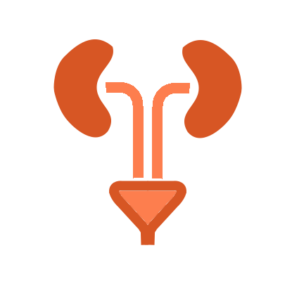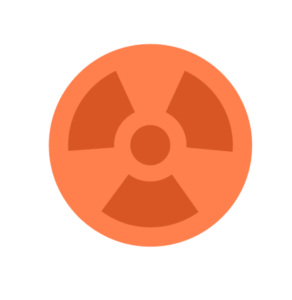Adénocarcinomes sans atteinte ganglionnaire mais avec amas cellulaires péricoliques ou périrectaux isolés : quelle valeur pronostique ? Comment les classer : stade II ou III ?
En raison du risque de rechute élevé, toutes les tumeurs colorectales sans atteinte ganglionnaire avérée mais présentant un ou plusieurs ACPI, quelle que soit leur forme ou leur taille, peuvent être classées Ptn1c et donc stade III avec les conséquences thérapeutiques qui en découlent.
Les amas cellulaires péricoliques ou périrectaux isolés (ACPI) sont définis comme des agrégats cellulaires néoplasiques situés dans la graisse péricolique ou rectale, clairement dissociés de la tumeur primitive et ne correspondant pas à une structure ganglionnaire. Leur valeur pronostique n’avait jamais été rigoureusement établie scientifiquement et les tumeurs y étant associées, mais ne présentant aucune invasion ganglionnaire, étaient classées stade II ou III au gré des différentes classifications internationales, sur des bases essentiellement empiriques. Dans la sixième classification de l’UICC, datant de 2002 (TNM6), la règle d’un ACPI de 3mm ou plus qui permettait un classement en stade III des tumeurs qui en étaient pourvues en l’absence d’atteinte ganglionnaire, prévalant dans la classification précédente (TNM5), a été abolie. Sans caractéristique minimale de taille, il suffisait alors qu’un ACPI présente « la forme et les contours arrondis d’un ganglion » pour que la tumeur soit classée stade III. La 7e édition de l’UICC datant de 2010 confirme que, s’il ne correspond pas à un ganglion, l’APCI est classé N1c et, par conséquent, la tumeur stade III.
Une clarification de la valeur pronostique des ACPI basée sur des preuves scientifiques solides s’imposait donc, notamment en raison de son implication thérapeutique potentielle. Ceci est maintenant chose faite grâce à ce travail hollandais publié dans Annals of Surgical Oncology [1].
Patients et méthodes
Ce travail rétrospectif a réuni au total 870 patients opérés entre 1996 et 2005 d’un cancer colorectal à l’Hôpital Kennemer Gasthuis (Haarlem, Pays-Bas). Les dossiers furent repris notamment pour connaître les éventuels traitements complémentaires réalisés et l’évolution ultérieure. Concernant les tumeurs de stade II (n = 325), les lames furent réexaminées par un pathologiste indépendant n’ayant pas connaissance de l’évolution ultérieure, et furent soigneusement notés les ACPI, leur taille, leur localisation, leur nombre, leurs formes et contours ainsi que la présence d’invasion vasculaire ou d’engainement périnerveux. Les patients n’ayant pas bénéficié d’une résection R0 furent exclus de l’analyse ainsi que ceux dont les données concernant le suivi étaient trop limitées.
L’analyse statistique s’intéressa ensuite aux relations entre ACPI et survenue d’une récidive.
Résultats
Sur la population globale des 870 patients, il fut noté 127 cas d’APCI, soit 14,8 %. L’incidence des APCI augmentait avec le stade de la maladie : 0% dans les stades I ; 9,2% dans les stades II ; 20,1 % en cas de stade III ; et enfin 34,7% dans les stades IV.
Concernant les tumeurs de stade II, une rechute fut notée dans 50,6 %des cas avec ACPI et 24,4% des cas sans ACPI, la différence étant significative (p < 0,01). En analyse multivariée, la présence d’un ou plusieurs APCI correspondait à un facteur de risque de rechute indépendant après ajustement pour les autres facteurs de risque connus : stade T ; différenciation cellulaire ; invasion vasculaire ; perforation ou occlusion inaugurale (Odds Ratio = 3,1 ; Intervalle de confiance 95%=1,4-6,9 ; p < 0,01).
Les courbes de survie sans récidive apparaissaient tout à fait superposables pour les stades II avec APCI et les stades III.
De même, pour les tumeurs de stade III, une récidive fut notée respectivement dans 65,1 et 39,1% des cas avec et sans ACPI (p < 0,01).
Aucune relation ne fut retrouvée entre la taille ou le nombre des ACPI et le risque de rechute.
Les patients présentant des tumeurs avec ACPI irréguliers affichaient un risque plus élevé de récidive que ceux présentant un ou plusieurs APCI de contours réguliers arrondis.
Commentaires
Parmi les patients opérés d’une tumeur colorectale de stade II, le risque est actuellement de ne pas traiter en adjuvant une sous-population à risque méconnu. En attendant les moyens modernes de la biologie moléculaire avec, en particulier, le développement en routine des signatures génomiques, il convient de rechercher les facteurs de risque clinique (occlusion ou perforation inaugurales) ou histopathologies (T4, nombre de ganglions insuffisant, invasion vasculaire, engainement périnerveux, faible différenciation). Au nombre de ceux-ci, il faut maintenant compter, grâce à cette étude de qualité, les amas péricoliques ou périrectaux isolés qui confèrent un risque de rechute équivalent à celui des tumeurs de stades III.
Référence
[1] Belt EJ Th, et al. Ann Surg Oncol 2010;17:3203-11.