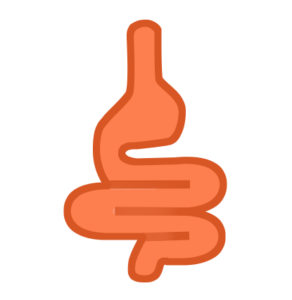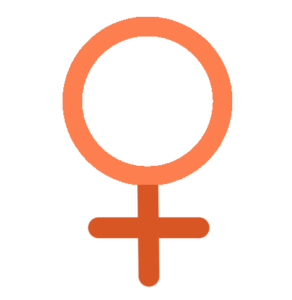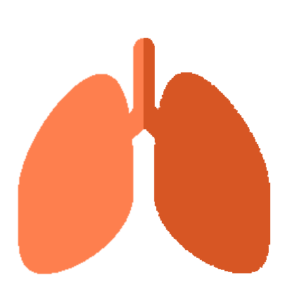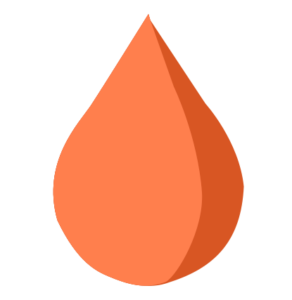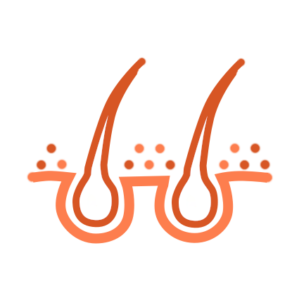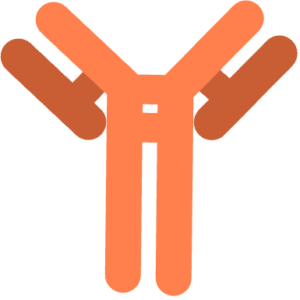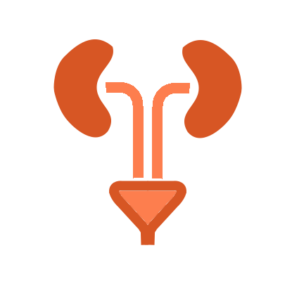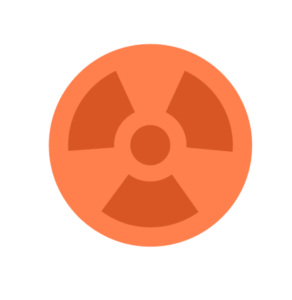Fréquence des colostomies (associées ou non à une amputation abdomino-périnéale) chez les patients traités par radio(chimio)thérapie pour un carcinome épidermoïde du canal anal.
Chez les malades atteints de carcinomes épidermoïdes du canal anal, les colostomies peuvent être réalisées soit à titre « thérapeutique », soit en raison de séquelles tardives sévères de la radio(chimio)thérapie. Le risque cumulé de ces colostomies est évalué à 25% et 8% respectivement dans cette étude rétrospective danoise. La grande majorité est réalisée dans les 2 premières années suivant la fin de la radiothérapie. Les nouvelles modalités d’administration de la radiothérapie devraient permettre de réduire significativement ce risque en optimisant le traitement de la tumeur et la protection des organes à risque.
Le traitement de référence des carcinomes épidermoïdes du canal anal localisés correspond à la radiothérapie, ou la radiochimiothérapie, l’amputation abdominopérinéale (AAP) étant généralement réservée aux échecs de ce traitement (défaut de contrôle tumoral ou récidive tumorale) ou à ses contre-indications (antécédent de radiothérapie pelvienne, incontinence ou destruction sphinctérienne). Des colostomies de dérivation (non associées à une AAP) sont également parfois indiquées, soit préalablement à la mise en route du traitement pour de volumineuses tumeurs symptomatiques, soit en raison de séquelles tardives sévères de la radio(chimio)thérapie alors que la stérilisation tumorale est acquise : fistules ; ulcères ; sténoses ; douleurs ; incontinence … Le taux de colostomie ou la survie sans colostomie correspondent donc à des paramètres pertinents pour l’évaluation du traitement, à la fois en termes d’efficacité et de toxicité tardive sévère.
L’étude rétrospective danoise de Sunesen et al. a évalué le taux cumulé de colostomies en fonction de leurs indications (colostomies « thérapeutiques » versus colostomies « pour séquelles ») chez 235 patients traités pour un carcinome épidermoïde du canal anal dans 4 centres hospitalo-universitaires danois entre 1995 et 2003 (1).
Tableau 1 : Fréquence et caractéristiques des colostomies réalisées chez les 235 patients inclus.
|
Colostomies « thérapeutiques » |
Colostomies « pour séquelles » tardives1 |
|
| Nombre |
n=64 |
n=18 |
| Incidence cumulée (IC95%) |
26% (21%-32%) |
8% (5%-12%) |
| Chronologie(par rapport à la fin de la RT)▪ dans les 2 ans▪ dans les 5 ans |
▪ n=57 (89% de l’ensemble) ▪ n=61 (95% de l’ensemble) |
▪ n=15 (83% de l’ensemble) ▪ n=18 (100% de l’ensemble) |
| Type de colostomie▪ associée à une AAP▪ non associée à une AAP | ▪ n=34▪ n=302 | ▪ n=6▪ n=12 |
AAP=Amputation Abdomino-Périnéale.
1 – Principales indications des colostomies pour séquelles tardives graves : ulcération chronique ; incontinence ; fistule recto-vaginale ; lésions cutanées ; sténose fibreuse du canal anal ; obstruction intestinale.
2 – Parmi les 30 colostomies « thérapeutiques » non associées à une AAP, 20 correspondaient à des colostomies pré-thérapeutiques réalisées chez les patients porteurs de volumineuses tumeurs circonférentielles et/ou associées à un envahissement d’un organe de voisinage, éventuellement abcédées.
Les modalités thérapeutiques étaient hétérogènes. La radiothérapie externe était délivrée selon un fractionnement « conventionnel » de 5 fractions hebdomadaires de 2 Grays. La dose totale délivrée à la tumeur était comprise entre 60 Gy et 64 Gy pour la majorité des patients (n=190=81% de l’effectif). L’irradiation pelvienne était associée à une irradiation des aires ganglionnaires inguinales dans la majorité des cas ; une curiethérapie a été délivrée chez 32 patients (14% de l’effectif), en complément de la radiothérapie externe dans 31 cas. Cent soixante deux patients (soit 69% de l’effectif) ont été traités par radiothérapie exclusive. Différentes modalités de chimiothérapie ont été administrées aux autres patients (généralement porteurs de tumeurs de stades T3-4 et/ou N2-3), de façon néo-adjuvante (n=35), concomitante à la radiothérapie (n=9) ou néo-adjuvante et concomitante (n=29). Une exérèse locale était réalisée avant la mise en route du traitement dans 28 cas, c’est-à-dire chez 12% des patients inclus.
Les résultats sont résumés dans le tabeau 1. Les taux cumulés de colostomies « thérapeutiques » et de colostomies « pour séquelles » étaient de 26% (IC95% : 21%-32%) et de 8% (IC95% : 5%-12%) respectivement. Près de la moitié des colostomies « thérapeutiques » (30/64) n’étaient pas associées à une amputation abdomino-périnéale. Il s’agissait dans 20 cas de colostomies pré-thérapeutiques réalisées le plus souvent chez des patients porteurs de volumineuses tumeurs, éventuellement associées à un envahissement d’un organe de voisinage ou abcédées. La très grande majorité des colostomies « thérapeutiques » ou « pour séquelles » était réalisée au cours de 2 premières années suivant la séquence thérapeutique. Une taille tumorale ≥ 6 cm était associée à une augmentation significative du risque de colostomie « thérapeutique » ; une exérèse locale préalable à la radiothérapie était liée à une augmentation significative du risque de colostomie « pour séquelles » tardives.
Il est important de souligner que les évolutions thérapeutiques actuelles du carcinome épidermoïde du canal anal permettent d’espérer une diminution significative du taux de colostomies. En effet, l’amélioration de la balistique permise par les nouvelles modalités d’administration de la radiothérapie (radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité ; tomothérapie hélicoïdale ; ARC thérapie) devrait permettre de diminuer significativement la toxicité tardive grâce à une meilleure protection des organes à risque. L’amélioration de la tolérance devrait également permettre d’évaluer l’efficacité de schémas d’administration continue et/ou d’une augmentation de la dose totale délivrée à la tumeur afin de tenter d’améliorer le taux de contrôle tumoral.
Référence
1 – Sunesen KG, Norgaard M, Lundby L, et al. J Clin Oncol 2011; 29: 3535-3540. Cause-specific colostomy rates after radiotherapy for anal cancer : a danish multicentre cohort study. J Clin Oncol 2011: 29: 3535-3540.